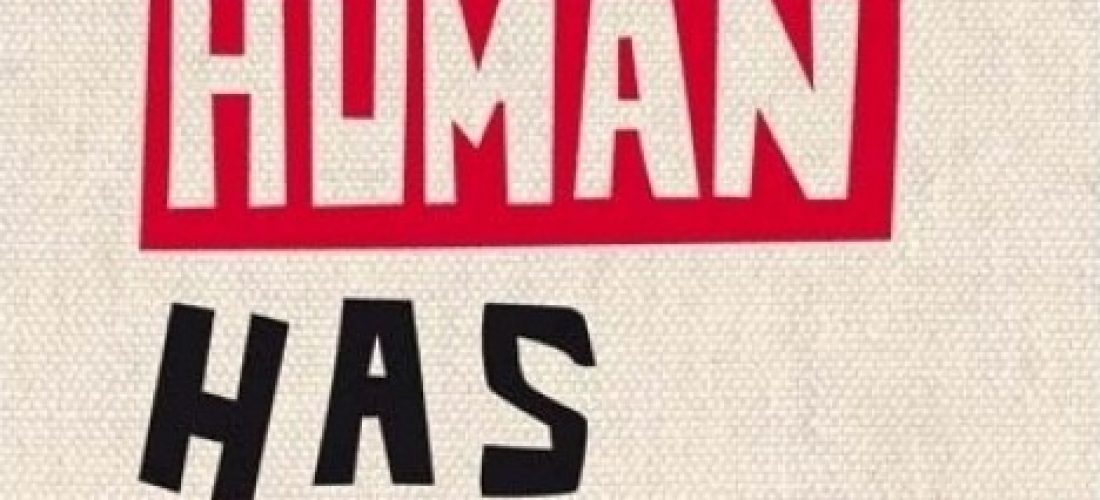Introduction. Le droit social dans la tourmente LE GOFF Jacques Article Introduction: Social legislation in turmoil. Jacques Le Goff
Travail et protection sociale : un droit malmené
Le droit social dans la tourmente*
18 septembre 2007. Devant l’Association des journalistes de l’information sociale réunie au Sénat, Nicolas Sarkozy lance son projet de « nouveau contrat social » axé sur trois grands thèmes : réhabilitation du travail, réforme du contrat de travail, réactivation du dialogue social. Objectif : relever ensemble le défi d’une économie mondialisée hyperconcurrentielle dont le centre de gravité s’est déplacé de l’Occident vers les pays émergents, prendre acte du primat de l’économie des services dans l’analyse de pratiques sociales au sein de l’entreprise par valorisation de l’initiative et de la responsabilité individuelles, tirer les conséquences de la nouvelle distribution des rôles entre le capital et le travail pour repenser le compromis fordien. Ce qui implique « modernisation » du droit du travail symbolisée au printemps 2008 par l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail.
18 septembre 2008. L’économie vient d’amorcer sa glissade sur la faille vertigineuse d’une crise majeure1. Le Monde relève, ce jour-là, que dans un « contexte difficile la gageure est de mettre en scène le volontarisme sarkozien alors que le politique semble démuni face aux contraintes extérieures2 ».
À un an de distance, le tableau ne diffère guère. Simplement, le volontarisme initial doit composer avec le séisme provoqué par la déconnexion, manifeste depuis plusieurs années, entre l’économie financière et l’économie réelle. Là où on voulait offensivement faire du « neuf » c’est l’ancien qui revient en boomerang sous la forme défensive des vieilles recettes du passé et spécialement du traitement social du chômage.
Que devient le droit du travail dans tout cela ? En pleine recomposition, il se cherche une nouvelle physionomie encore fort indécise dans un jeu de tensions exacerbées entre un individuel référentiel et un collectif profil bas ; entre un économique dragée haute y compris dans et par ses convulsions et un social en retrait ; entre un État qui tient à garder le contrôle de ses évolutions et des acteurs sociaux peinant, malgré certains frémissements, à se mettre d’accord sur une stratégie commune.
Ce dossier se propose de faire un bilan d’étape de ce droit par évocation des trois grands nœuds problématiques que constituent l’emploi et le marché du travail, l’évolution du statut salarié et les déplacements récents de la négociation collective. Il ne vise donc pas à l’exhaustivité mais au souci d’approcher au plus près les déplacements en cours.
Marché du travail : « faire sauter les verrous »
Depuis mai 2007, le mot d’ordre s’est imposé comme une nouvelle frontière : il faut « remettre la France à l’ouvrage » après le conte de fée des 35 heures « désastreuses pour la valeur travail ». Les Français seraient devenus autistes en perdant de vue le principe de réalité par abandon aux sirènes de la société du loisir, de la « fin du travail », des rêveries bucoliques. Avec de cuisantes conséquences : la perte de compétitivité sanctionnée par le déséquilibre de la balance des paiements et la perte de prestige sur la scène internationale.
D’où la résolution de « faire sauter les verrous » en commençant par neutraliser, sans le dire puis en l’affichant, l’acquis des lois Aubry I et II de 1998 et 2000. Compte tenu de la popularité des « 35 heures », le travail de sape sera préféré à l’attaque frontale. Officiellement, il n’est pas question de remettre en cause la mythique référence. Pratiquement, les coups de barre à mine s’enchaînent pour fragiliser l’édifice. La loi Tepa d’août 2007 avait habilement ouvert le chantier puisqu’il s’agissait, par le moyen de gratifications incitatives à la pratique des heures supplémentaires (exonérations…), d’en augmenter le volume et de faire éclater au regard de tous l’irréalisme foncier des 35 heures. Un an après, les effets du texte restaient toujours nébuleux. « En mars 2008, annonçait X. Bertrand, 60 % des entreprises étaient concernées. » Dans quelle proportion ? Mystère. Ce qui n’empêchait pas le ministre du Travail, serré de près par le très libéral P. Devedjian, d’activer les feux en vue « de faire sauter les verrous inutiles qui empêchent ceux qui le souhaitent de travailler ». Ce sera chose faite durant l’été 2008 (loi du 20 août) par touches successives : extension du forfait-jours à de nouvelles catégories de salariés et fixation du contingent des heures supplémentaires par négociation au niveau le plus décentralisé3, celui de l’entreprise. En sorte que, bien que maintenues, les « 35 heures » font désormais figure de référence nominale presque entièrement désactivée.
Fondée sur l’hypothèse d’une croissance raisonnable de 2 % à 4 %, cette option demeure-t-elle pertinente dans un contexte de l’emploi gravement et durablement détérioré ? Jean-Paul Fitoussi estimait en novembre, au lendemain de l’annonce d’une perte mensuelle de 44 000 emplois et du franchissement de la barre symbolique des 2 millions de chômeurs, que la tendance devrait se poursuivre encore un an. Outre que les « 35 heures » ont permis de créer et de maintenir près de 400 000 emplois, accéléré la modernisation des entreprises et amélioré leur productivité, à un coût humain il est vrai non négligeable (stress, troubles musculo-squelettiques…), il est permis de se demander si l’on n’en viendra pas à la redécouverte de leurs vertus redistributives de l’emploi après remise en selle du traitement social du chômage. Et puis, pourra-t-on longtemps encore différer le débat, bien engagé dans les années 1980-1990, sur l’avenir d’une société qui ne saurait se définir par la seule prise en compte de sa capacité productive de biens et de services. L’instant ne serait-il pas propice à semblable interrogation ?
C’est également sous l’horizon de la réhabilitation du travail que se comprend l’obstination du gouvernement à déplacer vers le haut le curseur de l’âge de départ en retraite ou bien encore le Revenu de solidarité active (Rsa) riche de promesses mais aussi lesté d’incertitudes et de probables effets pervers signalés par Jacques Rigaudiat.
La véritable urgence n’est-elle pas plutôt l’amélioration effective de la fluidité et de la transparence du marché du travail en vue de permettre l’allocation optimale des ressources d’emploi par intervention active et optimale des services de l’emploi ? L’entrée en fonction, en janvier 2009, du nouveau Pôle-Emploi regroupant l’Anpe et l’Assedic en lien étroit avec les directions départementales du travail constitue un réel progrès et une réponse que l’on peut, avec Jean-Claude Barbier, souhaiter adaptée « à la question majeure du marché du travail français, c’est-à-dire son émiettement et ses inégalités ». Et parmi ces inégalités, il en est une qui attend un traitement urgent, après tant de promesses différées : celle de la formation professionnelle « tout au long de la vie » qui demeure non seulement profondément inégalitaire mais insuffisamment opératoire du fait d’une atomisation de l’offre entre 50 000 officines d’un sérieux assez souvent problématique. Un projet de réforme est en cours. Il faut souhaiter qu’il aboutisse au plus vite, malgré les redoutables chausse-trapes du dossier. Et puis, toujours sur ce chapitre de l’emploi, comment ne pas s’étonner de l’état d’inorganisation des services à la personne à juste titre présentés comme un riche vivier d’emplois et, simultanément, abandonnés au flottement d’une demande ponctuelle, atomisée génératrice d’une grande précarité liée à la prolifération des temps partiels ? Combien des sept millions de travailleurs pauvres4 que compte notre pays n’exercent-ils pas dans ce secteur stigmatisant ?
De là l’importance d’une pensée renouvelée des garanties dans l’emploi.
Flexicurité à la française ?
La flexicurité est désormais au cœur du débat social comme le démontre l’Accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail à juste titre salué par François Fillon (« un vrai pas vers la flexicurité à la française ») et par Jean-Denis Combrexelle, le directeur des relations du travail au ministère du Travail (« un accord historique »). Rappelons-en l’enjeu : trouver le juste compromis entre les exigences de flexibilité dans un contexte de labilité de l’emploi et l’impératif de protection statutaire sous la forme de garanties adaptées. Une problématique désormais européenne, la Commission de Bruxelles en ayant fait, en juillet 2007, « un cadre de référence commun pour la transformation coordonnée des marchés du travail ».
Il se pourrait que cet Ani soit plus « historique » par son objet – de vraies concessions mutuelles sur des aspects importants du statut des salariés et de la vie de l’entreprise – que par ses dispositions qui amorcent une transformation significative plus qu’elles ne l’encadrent avec inventivité. Les garanties reconnues aux salariés ne sont pas pour autant anodines. Elles concernent l’orientation professionnelle des jeunes entrant sur le marché du travail, le maintien dans l’emploi par mobilisation de la formation, de la Validation des acquis de l’expérience (Vae) et de la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (Gpec) déconnectée des licenciements, autrement dit envisagée comme une pratique habituelle dans l’entreprise aux fins d’anticipation des évolutions. Par ailleurs est développée ce qui constitue la pierre de touche de la flexicurité à savoir la portabilité des droits, c’est-à-dire la possibilité de transférer d’un emploi à l’autre le bénéfice de droits capitalisés en matière de couverture complémentaire santé et de droit individuel à la formation (Dif). Le texte demeure plus évasif sur un point essentiel dans le dispositif danois, référence incontournable : le revenu de remplacement pour la période de chômage courant entre deux emplois. Il faut savoir qu’au Danemark l’allocation de chômage se situe à un haut niveau de protection (80 % de la dernière rémunération) et pour une durée de quatre ans mais sous un régime de contrôle rigoureux de la recherche effective d’emploi.
Peut-on parler de précarisation corrélative des statuts en vue d’une meilleure adaptation aux à-coups d’une conjoncture de plus en plus fluctuante ? Certaines dispositions peuvent donner l’impression de tendre en ce sens et particulièrement la nouvelle rupture par accord mutuel. Mais outre le fait que cette rupture ne constitue pas une vraie nouveauté sinon par les garanties qui l’accompagnent et spécialement le décalque du régime du licenciement (indemnités, accès de plein droit à l’assurance chômage), ce qui frappe c’est au contraire le souci clairement énoncé de conserver le contrat à durée indéterminée comme « forme normale et générale du contrat de travail » conformément d’ailleurs au Code du travail.
Il faut en effet rappeler, contre une opinion reçue qui fait de la précarité la norme pratique de référence, que 85 % des salariés relèvent d’un contrat à durée indéterminée (Cdi), l’erreur de perspective tenant pour une large part à ce que, dans les flux d’emplois, 7 salariés sur 10 accèdent à l’emploi sous statut précaire avant transformation en Cdi.
Pour autant, l’évolution des pratiques d’emploi au cours des dix ou vingt dernières années n’est pas sans susciter de réelles inquiétudes. La première est née de la tentation, à laquelle ont succombé bien des employeurs, de contourner le droit légal et conventionnel du travail par des stratégies hautement déstabilisatrices consistant à s’assurer avec des travailleurs d’une relation aussi pérenne que possible mais en les privant des garanties attachées à une relation aussi stable. C’est ainsi qu’ont proliféré les pratiques de fausse sous-traitance, de faux artisanat sanctionnées par les tribunaux et qui ont eu, au moins, ce mérite d’attirer l’attention sur le phénomène de la para-subordination5 à laquelle les pouvoirs publics portent attention, en France comme ailleurs. Par un heureux retournement de situation, on en est venu à se demander s’il n’y aurait pas lieu d’imaginer un « statut professionnel » transcendant partiellement le clivage traditionnel salariés/indépendants avec, comme toujours, le risque d’un effet pervers d’érosion de la catégorie la mieux protégée. La question s’est particulièrement posée à propos du portage salarial aujourd’hui entré dans le Code du travail après bien des hésitations.
Mais le vrai problème est probablement ailleurs, dans le retour massif, à la faveur de la crise comme de l’évolution des mentalités, de la logique contractuelle longtemps garrottée par la logique statutaire à l’œuvre dans le droit du travail depuis bientôt un siècle. On a vu se recréer entre l’employeur et le salarié un colloque singulier aménageant les conditions d’emploi par le biais de clauses spécifiques, indéfiniment multipliées (de résultats, d’objectifs, de mobilité…) au risque d’invalider l’encadrement réglementaire protecteur. Allait-on en revenir à l’illusion du contrat de louage antérieur au contrat de travail, celle de l’égalité des parties à la transaction ? Il n’a pas manqué de voix pour plaider la mutation du contrat de travail en contrat commercial dans la ligne défendue, aux États-Unis, par W. Bridges. Sans grand écho, à dire vrai. Au contraire, ce genre de discours a plutôt eu pour effet d’alerter les tribunaux sur les risques de dénaturation de notre droit. Outre qu’ils ont efficacement contenu le jeu des clauses contractuelles soumises à contrôle strict, on les a vus s’ingénier à renverser la tendance au profit des salariés eux-mêmes en « découvrant » dans le contrat des obligations jusqu’alors inaperçues et aussi importantes que l’obligation d’adaptation-reclassement en situation de licenciement économique ou l’obligation générale de sécurité au profit, d’abord, des victimes de l’amiante puis de l’ensemble des salariés.
Dans le même temps, qu’en est-il d’une démocratie sociale loin d’avoir « fait toutes ses preuves6 » ?
Dialogue social : de l’antagonisme au protagonisme ?
Jean-Paul Jacquier, ancien grand négociateur de la Cfdt, se désolait, il y a peu, de « l’introuvable dialogue social7 » en France. Le constat n’est pas nouveau. On sait, en effet, à quel point la négociation collective est chez nous, depuis la loi inaugurale de 1919, une pratique sans la foi8. Une pratique d’ailleurs remarquablement efficace du point de vue des résultats puisque nous sommes les premiers au monde par le taux de couverture conventionnelle (97 % des salariés du privé) et les derniers par le taux de syndicalisation. Un paradoxe aisément compréhensible si l’on reconnaît la part essentielle que prend l’État dans ce résultat imputable à la procédure d’extension par le ministre du Travail de textes qui, à défaut, n’intéresseraient qu’une faible part des salariés. Dès lors que tout travailleur syndiqué ou non bénéficie de l’accord conclu, à quoi bon se syndiquer ?
Pourtant, il semble bien que le dialogue social soit entré dans une nouvelle phase qui pourrait préluder l’accès à la majorité, c’est-à-dire à un début d’autonomie réelle. Peut-être…
Parmi les signes patents d’un changement, il faut d’abord prendre acte de la décrispation des relations entre les « partenaires » depuis l’accès de Mme Parisot à la tête du Medef et le tournant négociateur de la Cgt en voie d’abandon d’une posture systématiquement frondeuse. Pierre Rosanvallon l’avait justement diagnostiqué :
Le malaise français, on ne le dira jamais assez, est d’ordre intellectuel. C’est dans les têtes que se trouvent les blocages, les aveuglements et les peurs9.
Et c’est à ce niveau précisément que se réalise un lent déplacement d’imaginaire par substitution progressive du « protagonisme » dans une négociation transactionnelle à l’« antagonisme » systématique d’antan. Le fait que l’idée de « compromis » ne scandalise plus est bien le signe d’un changement culturel dont on discerne les manifestations aussi bien dans l’accord national sur le marché du travail de janvier 2008, non signé il est vrai par la Cgt, que dans la Position commune sur le développement du dialogue social du 9 avril 2008.
Il est rare que l’ensemble des partenaires souhaitent et parviennent à se mettre d’accord sur les règles générales d’organisation de leurs échanges entre eux et avec l’État.
On notera que la dynamique en cours, inaugurée par la précédente Position commune de juillet 2001, s’était vite accompagnée d’un effort de clarification des compétences entre la société et l’État. Initialement exprimée comme un souhait, tant par la Position que par la loi Fillon de mai 2004, la règle de priorité de la négociation est désormais inscrite dans le Code du travail dès ses premières lignes :
Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle… doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales… (article L. 1).
Chant du cygne du « néo-corporatisme » (Schmitter), forme de syncrétisme socio-étatique si parfaitement illustrée par le mode d’élaboration des lois Auroux en 1981-1982 (voir l’analyse de Jacques Le Goff) ? Rien n’est encore joué si l’on en juge au passage en force du gouvernement, durant l’été, sur la question des heures supplémentaires10 et à la tentation répétée de contourner les partenaires par recours aux amendements parlementaires en cours de débat mais sur des sujets « politiques » que précisément les syndicats répugnent à aborder de face.
Annette Jobert souligne à quel point la période se révèle riche de tous les possibles. Qu’il s’agisse de la réforme de la représentativité syndicale et des accords majoritaires visant dans les deux cas à remettre le système sur ses pieds par ancrage dans la réalité des rapports sociaux, qu’il s’agisse encore du décentrement accentué de la négociation en direction de l’entreprise avec élargissement de la marge de manœuvre, y compris à titre dérogatoire, aux normes conventionnelles supérieures, avec le risque d’autoréglementation excessive, on sent bien que quelque chose de nouveau se profile et d’autant plus que toutes ces évolutions pourraient induire une recomposition des forces syndicales par coalitions ponctuelles ou union plus durable au demeurant souhaitée par la grande majorité des salariés, ainsi qu’une remobilisation de la base afin d’aborder la négociation d’entreprise, aujourd’hui souvent très déséquilibrée, dans des conditions plus satisfaisantes.
C’est encore loin, l’Europe sociale ?
Plus que jamais, dans le contexte d’affaiblissement du social, se pose la question du niveau pertinent de déploiement de la démocratie sociale. Que peut-on espérer de l’échelle européenne ? Faut-il croire à l’Europe sociale ? La formule est sans doute appelée à réapparaître dans la campagne des élections européennes de juin 2009, surtout dans un contexte de crise économique et de forte progression du chômage qui va porter la question de l’emploi au premier plan des préoccupations à travers toute l’Europe. Mais que peut réellement l’Europe en la matière ? Comme le remarquent ici Marc Clément et Alain Supiot, il ne suffit pas de regretter les carences de l’Europe sociale, encore faut-il explorer les meilleures voies pour lui donner consistance. De fait, les questions sociales appartiennent aux « compétences partagées » entre l’Union et les États et cet entre-deux favorise bien des confusions.
La « convergence » des modèles sociaux européens présente en réalité deux faces. La première relève du constat : dans les comparaisons mondiales, les pays européens présentent des profils proches, en particulier par les garanties qui sont attachées à la condition salariale. On peut parler d’un « modèle social européen » dans la mesure où les pays européens combinent tous protection dans l’emploi, socialisation des principaux risques sociaux, mobilisation des partenaires sociaux et promotion de l’égalité. Cela se traduit par des transferts financiers puisque dans l’ensemble des pays de l’Union, l’effort social (niveau de dépense de protection sociale en pourcentage du Pib) mobilise environ un quart de la richesse créée11.
L’autre versant de la « convergence » interroge les perspectives d’une politique commune de l’Union en matière sociale. Il ne suffit pas dans ce domaine de souhaiter une harmonisation par le haut, il faut se confronter à l’observation de la multiplicité des modèles sociaux à travers l’Europe. De nombreux auteurs s’accordent avec Gøsta Esping-Andersen pour relever la coexistence de différents types de systèmes sociaux en Europe12. Les dispositifs de protections ne sont pas seulement des constructions techniques : ils sont encastrés dans des configurations sociales et culturelles qui présentent chacune leur cohérence. Ces différences institutionnelles ne sont pas seulement dues à des pesanteurs historiques, elles traduisent des compromis politiques et sociaux dynamiques.
La comparaison européenne incite ici à observer comment des systèmes institutionnels confrontés à des contraintes analogues réagissent selon leurs capacités propres et leurs arbitrages nationaux. Ainsi les pays européens ont-ils été confrontés aux mêmes transformations des systèmes productifs : fin du taylorisme, démarche qualité, juste-à-temps, zéro défaut, mise en responsabilité des salariés, recherche de l’innovation, suppression des niveaux hiérarchiques intermédiaires, sous-traitance généralisée, etc. La « nouvelle trajectoire de croissance13 » (économie de l’innovation, insertion dans la concurrence mondiale, financiarisation…) venue des États-Unis a jeté des doutes sur le « modèle économique européen », en particulier sur les rigidités de son marché de l’emploi. De multiples programmes de réforme ont été menés dans ce contexte, entretenant un fort sentiment de précarisation et d’insécurisation des salariés, dans lesquels le discours moralisateur sur les droits et les devoirs, le recours aux mécanismes de marché ont été largement dominants (voir la présentation du livre de Jean-Claude Barbier par Marc Clément). La « troisième voie » s’est proposée comme un programme destiné à renouveler l’approche de la protection dans l’ensemble des pays. Même si aucune recette n’a été adoptée de manière identique à travers l’Europe, tous les pays européens ont conduit des stratégies d’assouplissement de la protection liée à l’emploi14.
Mais la « troisième voie » s’est essouflée et la dynamique de croissance américaine vient de montrer ses limites. Avec elles, l’idée d’un modèle unificateur s’est affaiblie. Partout, la crise provoque le retour de l’État15. Et ce retour se traduira sans doute par l’accentuation des spécificités nationales, y compris dans le mode de négociation collective.
Au final, peut-on concevoir un modèle européen qui ne soit pas seulement défensif ou résiduel ? S’il semble difficile d’anticiper la manière dont une nouvelle dynamique de croissance pourra s’enclencher au terme de la crise actuelle – et quelle transformation celle-ci supposera dans l’organisation du travail -, le projet européen doit s’attacher à lier travail et protection dans le cadre d’une démocratie sociale active. Cela signifie notamment étendre la sécurité au-delà des risques classiques de la maladie et de la perte d’emploi, en y incluant la formation, les transitions sur le marché du travail, la conciliation du travail et de la vie privée et l’égalité professionnelle16. La protection ne doit plus seulement porter sur une situation d’emploi mais s’élargir à la prise en compte des trajectoires des individus pour garantir une sécurité économique tout au long de la vie. Il lui revient de traduire la conviction que, comme le dit Alain Supiot, « une économie qui maltraite les hommes n’a pas d’avenir ».
Jacques Le Goff
* Ce dossier s’inscrit dans la continuité de nos précédents numéros « Dans la tourmente (1). Aux sources de la crise financière », Esprit, novembre 2008 et « Dans la tourmente (2). Que fait l’État ? Que peut l’État ? », Esprit, décembre 2008.
1. Pour un diagnostic clair de la situation présente, voir M. Aglietta, la Crise. Pourquoi en est-on arrivé là ? Comment s’en sortir ?, Paris, Michalon, 2008.
2. 18 septembre 2008.
3. L’augmentation du nombre d’heures supplémentaires travaillées dans les entreprises de plus de 10 salariés s’est faite au détriment du travail des intérimaires selon une note de la Dares : « L’emploi intérimaire au deuxième trimestre 2008 », octobre 2008, Premières informations, premières synthèses, www.travail-solidarité.gouv.fr
4. D. Clerc, la France des travailleurs pauvres, Paris, Grasset, 2008 ; S. Paugam et N. Duvoux, la Régulation des pauvres, Paris, Puf, 2008.
5. Témoin, le récent rapport de P.-H. Antonmattéi et J.-C. Sciberras, le Travail économiquement dépendant : quelle protection ?, Paris, La Documentation française, 2008.
6. François Chérèque, Le Monde, 30 août 2006.
7. Titre de son dernier ouvrage aux Presses universitaires de Rennes, 2008.
8. Voir J. Le Goff, Droit du travail et société, T. II : les Relations collectives de travail, Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 523 sqq.
9. Pierre Rosanvallon, la Nouvelle critique sociale, Paris, Le Seuil, 2006, p. 8.
10. En passant outre aux dispositions de la Position commune d’avril 2008.
11. Yves Chassard et Jean-Louis Dayan, « Le modèle social européen est-il soluble dans la mondialisation ? », La Note de veille, no 109, Centre d’analyse stratégique, septembre 2008.
12. Voir Gøsta Esping-Andersen, les Trois mondes de l’État-providence, Paris, Puf, 1999 et dans Esprit : « Quel État-providence pour le xxie siècle ? Convergences et divergences des pays européens », février 2001. Voir aussi plus récemment, avec Bruno Palier, Trois leçons sur l’État-providence, Paris, La République des idées/Le Seuil, 2008.
13. Bruno Amable, les Cinq capitalismes. Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation Paris, Le Seuil, coll. « Économie humaine », 2005, p. 9.
14. Ibid.
15. Voir nos deux précédents numéros « Dans la tourmente » 1 et 2, novembre et décembre 2008.
16. Y. Chassard et J.-L. Dayan, « Le modèle social européen est-il soluble dans la mondialisation ? », art. cité.
Bibliographie
Revues
« Quel droit pour la négociation collective de demain ? », Droit social, janvier 2008.
« Flexicurité et réforme du marché du travail », revue Travail et emploi, janvier-mars 2008.
« L’Accord national sur la modernisation du marché du travail », Droit social, mars 2008.
« Un nouveau droit de la relation de travail ? », Droit social, juin 2008.
« Formation professionnelle : nouveaux chantiers », Droit social, décembre 2008.
Livres
Thomas Amossi, Catherine Bloch-London et Loup Wolff, les Relations sociales en entreprise, Paris, La Découverte, 2008.
Jean-Claude Barbier, la Longue marche vers l’Europe sociale, Paris, Puf, 2008.
Pierre Boisard, Sortir du chômage, Paris, Mango, 2007.
Centre d’étude de l’emploi, le Contrat de travail, Paris, La Découverte, 2008.
Christophe Degryse et Philippe Pochet, Bilan social de l’Union européenne, Bruxelles, Etui-Rhes, 2008.
Bruno Denis, la Modernisation du marché du travail, Paris, La Documentation française, 2008.
Mireille Elbaum, Économie politique de la protection sociale, Paris, Puf, 2008.
Gøsta Esping-Andersen avec Bruno Palier, Trois leçons sur l’État-providence, Paris, La République des idées/Le Seuil, 2008.
Annette Jobert, Sociologie du travail : les relations professionnelles, Paris, Armand Colin, 2008.
-, Travail et emploi en France : état des lieux et perspectives, Paris, La Documentation française, 2006.
Michel Lallement, le Travail : une sociologie contemporaine, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2007.
Jacques Le Goff, Du silence à la parole. Une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours, Presses universitaires de Rennes, 2006.
-, les Lois Auroux, 25 ans après. Où en est la démocratie participative ?, Presses universitaires de Rennes, 2008.
Sandrine Maillard, l’Émergence de la citoyenneté sociale européenne, Presses de l’Université d’Aix-Marseille, 2008.
Bruno Palier, Gouverner la sécurité sociale. Les réformes du système français de protection sociale depuis 1945, Paris, Puf, 2005.
Maria Joao Rodrigues, l’Europe, quel modèle économique et social ?, Paris, CulturesFrance, 2008.
Alain Supiot, Critique du droit du travail, Paris, Puf, 2007.